Votre cabinet en droit du travail
et de la sécurité sociale.
Votre cabinet en droit du travail
et de la sécurité sociale.
Désormais, les salariés absents dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie, qu'il soit d’origine professionnelle ou non, ont le droit d'acquérir des congés payés.
C'est une petite révolution qui a démarré le 13 septembre 2023 lorsque la chambre sociale de la Cour de cassation, par 5 arrêts (n°22-17.638 ; n°22-17.340 ; n°22-17.342 ; n°22-10.529 ; 22-11.106), a sonné le glas des dispositions législatives antérieures, et qui s'est poursuivie par l'entrée en vigueur de la loi DDADUE n°2024-364 adoptée le 22 avril 2024.
Ce n’était, en réalité, pas une surprise : nous savions depuis déjà plusieurs années que le code du travail français n'était pas conforme à la réglementation européenne.
En effet, alors que la directive européenne du 4 novembre 2003 relative au temps de travail et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoient un droit fondamental au repos pour les travailleurs d'au moins 4 semaines par an quelle que soit leur situation (temps de travail effectif ou absence), les articles L.3141-3 et L.3141-5 du code du travail français limitaient l'acquisition de congés payés au seul salarié en arrêt maladie pour accident du travail ou maladie professionnelle, et ce dans la limite de la première année d'arrêt. Après cette première année, ou lorsque les salariés bénéficiaient d'un arrêt de travail d'origine non professionnelle, aucun droit à congé payés n'était ouvert.
C'est en l'absence de transposition par l'État français du droit européen (pour laquelle l’Etat français a d’ailleurs été condamné récemment - CAA de Versailles, 17 juillet 2023, n°22VE00442), et après de multiples alertes dans son rapport annuel, que la Cour de cassation a décidé, le 13 septembre 2023, d'inciter le législateur à modifier les règles applicables à l'égard des salariés en arrêt de travail.
Les employeurs avaient beau être préparés, le coup n'en a pas été moins violent, dès lors que le choix de la Cour de cassation a été d'octroyer un droit non limité aux salariés ; à savoir non limité en nombre de jours acquis (qu'elle ne limitait pas à 4 semaines par an comme le droit européen et qui semblait viser à la fois les congés légaux mais également les congés conventionnels), et en durée (puisque la Cour de cassation semblait indiquer que les droits du salarié ne pouvaient pas être prescrits s'il n’avait pas été mis en mesure de prendre les congés auquel il avait le droit, ce qui se révélait bien vite inapplicable en pratique puisque la majeure partie des employeurs n’avait jusqu’à présent octroyé aucun droit particulier aux salariés en arrêt de travail.
Après la consultation du Conseil d'état par le gouvernement (avis rendu le 13 mars 2024) et un avis du Conseil constitutionnel (avis du 8 février 2024) c’est donc le 22 avril 2024 que la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne a été adoptée, publiée au Journal officiel le 23 avril 2024 pour une entrée en vigueur le 24 avril 2024.
Notons par la suite l'émission par la DGT de certaines précisions pratiques en avril 2024, suivies d'un « questions-réponses » intégrées désormais dans le Code du travail numérique.
C'est avec L'ensemble de ces textes qu'il faut désormais travailler, pour appliquer au mieux la réforme des congés payés et les nouvelles règles qui s'appliquent depuis quelques semaines.
En 12 questions, voyons quelles sont ces nouvelles règles.
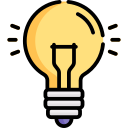
Toutes ces dispositions doivent bien évidemment être revues à l'aune des dispositions conventionnelles et du statut collectif qui s'appliquent au sein de chaque entreprise. Il convient à cet égard d’être prudent dès lors que certaines conventions collectives de branche prévoient déjà des dispositions plus favorables en matière d'acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie que les nouvelles dispositions légales.
La loi est applicable aux salariés du secteur privé et exclut les fonctionnaires et salariés de droit public.
Elle est applicable aux salariés ayant été en arrêt de travail à partir du 24 avril 2024 ou bien, pour les dispositions rétroactives, à partir du 1er décembre 2009.
On notera une interprétation assez extensive par la DGT du texte, qui considère que l'ensemble des arrêts de travail ayant eu lieu sur la période de référence en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi, à savoir, pour les entreprises qui appliquent les dispositions classiques, la période de référence allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Ce point reste pour autant en suspens dès lors que la loi ne précise pas explicitement s'il convient de se placer exactement au 24 avril 2024 ou non pour l'application de ces règles.
Qu'entendons-nous par « arrêt de travail » ?
Il faut comprendre par le terme « arrêt de travail » l'ensemble des arrêts qui peuvent être considérés comme justifiant une absence et une suspension du contrat de travail. Cela vise notamment l’arrêt maladie émis sur un CERFA classique par le médecin traitant, mais également les bulletins d'hospitalisation. Ne sont pas pris en considération les critères d'indemnisation par la sécurité sociale ou encore de droit à une période de maintien de salaire : ces critères importent peu puisque la condition qui nous intéresse est celle de l'existence d'un arrêt de travail en bonne et due forme.
En revanche, doit être exclu du champ d'application de la loi tout salarié absent sans avoir pu justifier sa période d'absence par un arrêt de travail conforme.
Un certain nombre de règles ne sont pas modifiées par l'entrée en vigueur de la loi DDADUE.
En effet, seules les règles en matière d'acquisition de congés payés sont en réalité modifiées par ces dispositions. Les employeurs doivent donc garder à l'esprit qu'un certain nombre de règles doivent toujours être appliquées, y compris dans le cadre de la présente réforme :
Concernant cette question en particulier, il convient toujours d'opérer une distinction entre les salariés bénéficiant d'un arrêt de travail d'origine professionnelle ou non professionnelle.
Attention : cette règle ne signifie pas que les absences d'origine non professionnelle doivent être assimilées à du temps de travail effectif en toutes circonstances ! Il s'agit en réalité d'une règle qui ne s'applique qu’en matière d'acquisition de congés payés. À date, par exemple, l'ancienneté est toujours suspendue pour les salariés en arrêt de travail d'origine non professionnelle.
Le droit acquis équivaut à 2 jours ouvrables par mois, soit 24 jours ouvrables maximum par période de référence (article L.3141-5-1 du Code du travail).
Pour ces arrêts, la limite d'un an précédemment applicable pour l'acquisition des congés payés est supprimée.
L'indemnité de congés payés subit également quelques changements puisqu'elle suit le régime désormais applicable pour l'arrêt de travail qui la concerne. Ainsi, pour les salariés en arrêt de travail pour maladie simple, la rémunération de référence pour le calcul de l'indemnité sera prise en compte à hauteur de 80% de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir s'il avait travaillé (article L.3141-24 du Code du travail).
Le sujet de l'accident de trajet n'a pas été abordé par le législateur. Il conviendra éventuellement de se référer à la jurisprudence en matière d'accident de trajet laquelle assimile ce type d'accident un accident du travail, donc à du temps de travail effectif, pour l'acquisition des congés payés (Cass. Soc. 3 juillet 2012, n°08-44.834)
Ces règles sont prévues aux articles L.3141-19-1 et -2 du Code du travail
La réforme des congés payés a instauré un délai de report des congés payés acquis et non pris au cours de la période de prise prévue en raison d'un arrêt de travail. Ce délai de report est, dans la loi, fixé à 15 mois, quelle que soit l'origine de l'arrêt. Il pourra éventuellement être augmenté par accord collectif de branche ou d'entreprise.
Attention : ce terme d'impossibilité de prendre ses congés peut être soumis à interprétation. Nul doute que des contentieux auront pour objet l'interprétation de cette notion. La prudence s'impose du côté de l'employeur.
À l'issue du délai de report, si le salarié n'a pas pris ses congés, il les perd.
Néanmoins, tout n'est pas si simple !
En effet, la jurisprudence classique en matière de congés payés nous semble encore pertinente ici, à savoir que le salarié doit avoir été mis en mesure de prendre ses congés par l'employeur : à défaut, il ne perd pas son droit à congé. Il s'agit désormais d'une jurisprudence constante en matière de congés, qui tend depuis quelques années à couvrir de nombreuses situations et à rendre les contentieux en matière de congés payés assez complexes et défavorables à l'employeur.
Pendant la période de report, l'employeur reste titulaire du pouvoir d'imposer les dates des congés quelle que soit la nature de ceux-ci, qu'ils aient été acquis avant un arrêt, pendant un arrêt, ou après un arrêt, et qu'ils aient été reportés ou non.
Cela signifie que s’il respecte les règles légales et réglementaires ainsi que les délais d'information prévus par le code du travail ou la convention collective applicable, l'employeur sera tout à fait en droit d'imposer les dates des congés, même reportés, à son salarié.
Le point de départ du délai de report varie selon la durée de l'arrêt de travail (article L.3141-19-3 du Code du travail).
En revanche, en cas de reprise avant l'expiration du délai de 15 mois, alors ce délai se trouve suspendu et le salarié doit être informé du droit à ses congés payés pour que le reste du délai de report s’écoule.
L'information du salarié doit concerner à la fois le nombre de jours de repos dont il dispose, et la date jusqu'à laquelle les jours de congés payés peuvent être pris (article L.3141-19-3 du code du travail).
L'information doit être réalisée dans un délai d'un mois suivant la reprise du travail.
Attention ! A cet égard, subsistent quelques zones d'ombre.
La question qui se posera sera donc de savoir si l'information peut véritablement être effectuée, en cas de contestation, comme le texte nous l'indique via un bulletin de paie, ou s'il convient d'être beaucoup plus prudent et d'adopter des méthodes probatoires plus sécurisées telles que le recommandé avec accusé de réception, la lettre remise en main propre contre récépissé, au risque de déclencher des difficultés pratiques et des lourdeurs administratives non négligeables.
La question de savoir quel est l'impact du non-respect du délai d'un mois précité reste également en suspens. Si l'interprétation générale est favorable à une possibilité d'informer après ce délai d'un mois, qui n’aboutirait donc qu’à un report de la date de début du délai, cela reste incertain et nous devrons attendre les premiers contentieux pour en savoir plus sur cette question.
Oui, la loi contient des dispositions rétroactives, lesquelles seront considérées comme étant applicables depuis le 1er décembre 2009.
Pour comprendre comment la rétroactivité fonctionne en matière de congés payés, il convient de distinguer les salariés encore en poste des salariés ayant quitté l'entreprise.
D'ores et déjà, il doit être précisé que les salariés qui sont encore en poste ne peuvent, en contentieux, faire que des demandes d'imputation des congés payés qui auraient dû leur être octroyés sur leurs bulletins de paie. Ils ne peuvent pas demander une indemnité compensatrice de congés, au contraire des salariés qui ont quitté l'entreprise qui, eux, ne peuvent faire que des demandes financières.
Les salariés en accident du travail et maladies professionnelles ne bénéficient donc pas des nouvelles dispositions à compter du 1er décembre 2009 ! Cela signifie que la limitation de leurs droits à acquisition des congés payés à la première année d'arrêt de travail reste en vigueur jusqu’au 23 avril 2024. Des questions restent en suspens à cet égard, et notamment celle de savoir si en contentieux, les salariés dans une telle situation pourraient obtenir des droits supplémentaires sur le fondement des arrêts du 13 septembre 2023 qui ne faisaient pas de distinction selon la nature de l'arrêt de travail, ou encore si les salariés en accidents du travail et maladies professionnelles depuis le 1er juin 2023, c'est-à-dire depuis le début de la période d'acquisition pendant laquelle la nouvelle loi est entrée en vigueur, pourraient éventuellement bénéficier des nouvelles dispositions à partir de cette date.
De manière générale, les salariés encore en poste auront jusqu'au 23 avril 2026, soit une durée de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, pour agir en justice.
Ce plafond signifie que les salariés qui ont déjà bénéficié d'un droit global à hauteur de 24 jours ouvrables, tout type de congés payés et toute période confondue, sur les périodes de référence antérieures au 24 avril 2024, ne pourront plus solliciter de congés payés supplémentaires.
Ils seront considérés comme ayant été remplis de leurs droits quand bien même ces derniers n'auraient pas vu leur période d'arrêt de travail leur donner droit à des jours de repos.
Tous les salariés ne pourront pas agir en justice, loin de là.
Les salariés qui ont signé des transactions couvrant l'indemnité compensatrice de congés payés ne devraient pas pouvoir bénéficier des nouvelles dispositions, de même que les salariés qui sont déjà en contentieux contre leur employeur et qui n'auraient pas formulé de demande de ce type alors que le délai de prescription est échu.
À cet égard, il doit être noté une position divergente des juges du fond en matière de recevabilité des demandes nouvelles au titre de l'acquisition de congés payés sur des périodes d'arrêt maladie lorsque les instances sont déjà en cours.
La Cour de cassation ayant été amenée à se prononcer tout récemment sur ce sujet en rappelant l'application des règles classiques en matière de procédure civile à ces demandes (Cass. Soc. 10 juillet 2024 n°22-16805).
Vous voulez en savoir plus ? pour cela, deux solutions !
Accédez à notre book RH spécial réforme des congés payés - en vente ici